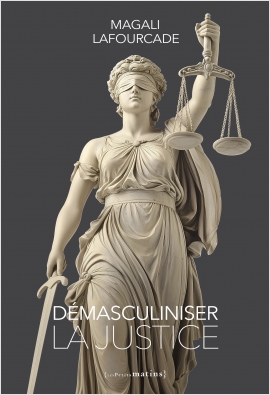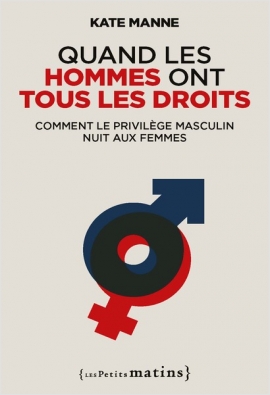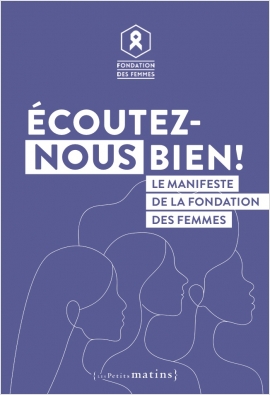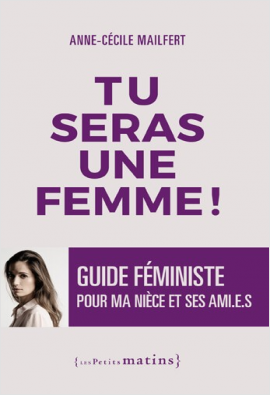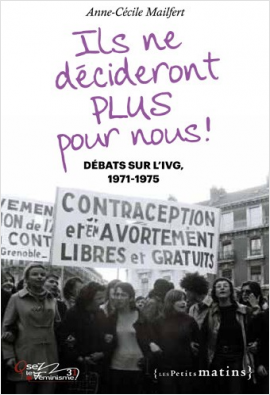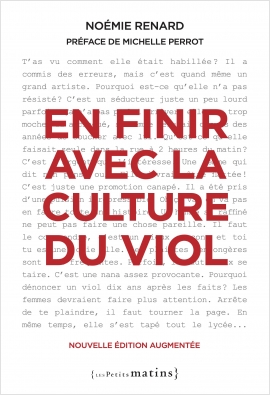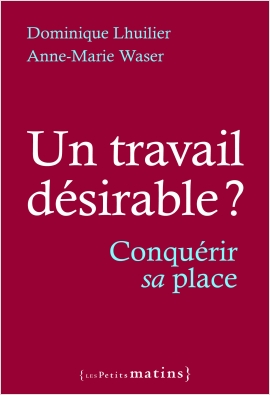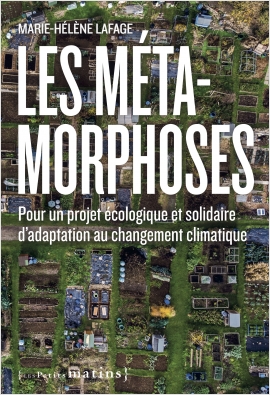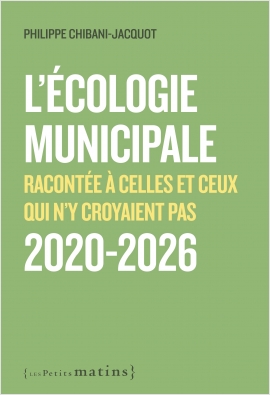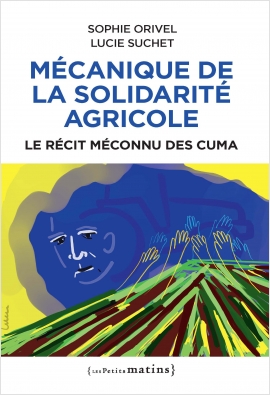En finir avec la culture du viol (nouvelle édition)
La 3e édition actualisée d'un livre paru en 2018 puis en 2021, pleinement inscrit dans l'intense mouvement de libération de la parole liée au viol et à l'inceste.
Les violences sexuelles envers les femmes n'apparaissent pas spontanément. Elles ne font pas partie de la << nature humaine>> ni ne sont le résultat d'incontrôlables pulsions masculines. Elles ont des causes sociales --- impunité des agresseurs, idées reçues sur la sexualité, inégalités structurelles --- qui forment ce que l'on appelle une << culture du viol >>. Cela va de remarques qui culpabilisent les victimes à un traitement trop fréquent des viols comme des délits plutôt que comme des crimes devant les tribunaux ; de formules pour excuser les agresseurs à une remise en cause de la parole des victimes.
Depuis la première édition de ce livre en 2018, plusieurs événements ont contraint la société à porter un nouveau regard sur ces questions. Le mouvement Me Too est passé par là, de même que des affaires emblématiques telles que le procès Pélicot ou les révélations sur l'Abbé Pierre. Une libération de la parole, et surtout de l'écoute, contraste avec les silences du passé. Il n'en reste pas moins que les violences sexuelles demeurent très peu pénalisées en comparaison des autres crimes et délits. Cette impunité constitue une atteinte aux droits et à la dignité des personnes et consolide la domination masculine.
Mais cette situation n'est pas une fatalité. C'est pourquoi il est important d'identifier les éléments culturels qui servent de justification et de terreau aux violences sexuelles, afin de proposer des pistes pour y mettre fin.
<< Ce livre d'une actualité brûlante propose une réflexion fondamentale pour nourrir les débats qui parcourent notre société. >>Michelle Perrot, historienne et professeure d'histoire émérite à l'université Paris-Diderot.
Acheter ce livre
Infos
Dans les médias

Noémie Renard interviewé par le Mouvement du nid
Le mouvement du nid , association qui lutte pour l'accompagnement, la prévention et contre l'isolement des prostituées, a rencontré Noémie Renard pour parler de son livre En finir avec la culture du viol.

« Chaque jour ou presque, les rubriques faits divers des journaux viennent illustrer ce sur quoi Noémie Renard, chercheuse en biologie, insiste dans son ouvrage. » - Hélène Bekmezian dans Le Monde
"« Comment imposer le « temps long » au politique ? Il ne s'agit pas d'étendre les mandats à quinze ans. Un très bon moyen de s'affranchir de cette pression de l'instantané, c'est de déporter une partie de la responsabilité en dehors du champ de l'exécutif ou de la majorité, pour la placer entre les mains de citoyens tirés au sort. Ces citoyens n'ont pas d'enjeux électoraux. En plus cela évite les erreurs : si on avait testé la taxe carbone devant une convention citoyenne, on se serait rendu compte qu'il y avait un blocage, et on aurait pu éviter les gilets jaunes. »"
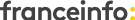
"Pourquoi a-t-on du mal à croire les victimes ?"
Dans un long entretien accordé à Élise Lambert, Noémie Renard revient sur les thèses principales de son livre. Qui permettent, ici, de comprendre les enjeux du traitement médiatique de "l'affaire Neymar", mais aussi d'insister, une fois de plus, sur la dimension culturelle, largement diffuse et invisibilisée du viol.

"Dans un essai très éclairant, la créatrice du blog antisexisme.net explique les fondements de la culture du viol. [...] Cet ouvrage est nécessaire pour que la société évolue."

"Ce terme de grève me dérange"
Noémie Renard donne son avis, aux côtés d'autres militantes féministes, sur le mouvement de "grève du sexe" . Retrouvez tous ses arguments dans le n°101 de la revue !

Les vidéastes de Parlons Peu, Mais Parlons...ont consacré une vidéo s'attachant à déconstruire les préjugés sur le viol en s'appuyant sur le livre de Noémie Renard.

Interview minute de Noémie Renard
Dans une courte vidéo, Noémie Renard nous parle de son livre En finir avec la culture du viol pour Le Groupe F, qui propose chaque semaine une action et une info pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles.
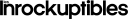
« Noémie Renard décrypte les dysfonctionnements et les préjugés culturels qui forment le terreau des violences sexuelles. Quelle est l'étape suivante après Weinstein, #metoo et #balancetonporc ? Celle du bilan, de l'analyse et des propositions. C'est toute l'ambition de En finir avec la culture du viol, petit précis informé, pédagogue et volontaire »

Noémie Renard était l'invitée de Victoire Tuaillon dans son podcast Les Couilles sur la table, émission consacrée à la masculinité produite par Binge Audio.

Noémie Renard pour Konbini !
Noémie Renard était l'invitée de Konbini pour parler de son livre En finir avec la culture du viol!

La vidéaste Antitésie a réalisé une revue vidéo du livre de Noémie Renard. La vidéo est parfaite si vous désirez explorer en détail le contenu du livre.

En finir avec la culture du viol est dans la liste de noël féministe de Slate !
"Votre sœur en a marre de voir des collègues raconter quotidiennement des horreurs sur les femmes, expliquer qu'une petite main aux fesses, c'est quand même pas un viol, et qu'on en fait tout de même beaucoup avec ces histoires de #MeToo. Et parce qu'elle en a marre de fulminer toute seule et qu'elle voudrait pouvoir leur clouer le bec, il faudrait lui offrir En finir avec la culture du viol, dont le titre n'est pas très «esprit de Noël», mais que voulez-vous: c'est une description parfaite du monde dans lequel nous vivons.D'une précision redoutable (chaque mot est soigneusement pesé, chaque argument est ciselé), le livre de Noémie Renard offre en outre une kyrielle de statistiques à envoyer dans la tronche de ceux --et de celles-- qui pensent que le harcèlement sexuel au travail est un problème de niche et que les viols sont systématiquement perpétrés par des inconnus, en pleine nuit, sur des filles court-vêtues. On n'a jamais fait mieux que les chiffres sourcés pour faire taire les champions du mansplaining."

Entretien avec l'association Internationale des victimes de l'inceste
Noémie Renard répond aux questions de l'Aivi, à l'occasion de la sortie de son livre En finir avec la culture du viol.

"Noémie Renard souligne, avec une grande justesse, à quel point le viol doit être dépouillé de toutes les idées reçues qui en déforment la perception, générant ainsi une certaine forme de laxisme crasse." - Martine Roffinella

"Le concept de « culture du viol » n'est malheureusement pas toujours bien compris. On pense à un encouragement, à une célébration du viol, alors qu'il s'agit surtout d'inertie et de vieux réflexes. On ne saura donc trop recommander la lecture d'un essai tout récent, qui synthétise brillamment ces enjeux : En finir avec la culture du viol , aux éditions Les Petits Matins. Son auteure, Noémie Renard , fournit une quantité redoutable d'exemples concrets." - Maïa Mazaurette

"Elle apporte un éclairage précis et édifiant, une vraie prise de conscience !"
Le blog féministe [Mots silencieux] propose une recension enthousiaste du livre de Noémie Renard : "En finir avec la culture du viol est, pour moi, un livre à mettre entre toutes les mains. Noémie Renard s'inscrit dans la lignée des plus grandes essayistes féministes."